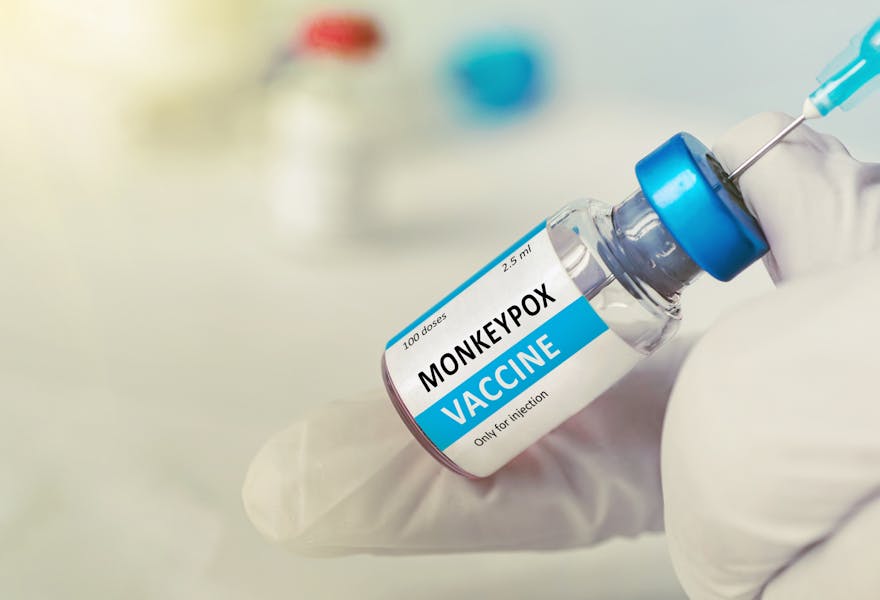Due au virus Monkeypox, la variole du singe (ou orthopoxvirose simienne) est transmise à l’homme par les animaux, ou entre êtres humains. Si le virus est surtout présent en Afrique du centre et de l’ouest, cette maladie infectieuse fait l’objet d’une surveillance renforcée depuis quelques mois en France et en Europe. Plusieurs cas ont en effet été signalés, sans lien direct avec un voyage dans des pays à risque.
Alors quels sont les symptômes de la variole du singe ? Comment détecter et soigner la variole du singe ? Et peut-on se protéger contre cette maladie ?
La variole du singe, qu’est-ce que c’est ?
La variole du singe est une infection virale rare, provoquée par l’orthopoxvirus simien (le virus Monkeypox, qui s’apparente au virus de la variole). Le virus peut être transmis à l’homme par un animal (on parle aussi de zoonose virale), ou par un autre être humain. La maladie provoque des symptômes semblables à ceux de la variole, mais reste généralement moins grave.
Une maladie infectieuse virale
La variole du singe est une maladie infectieuse due à un virus : le Monkeypox (virus de la variole du singe). Le virus a été isolé pour la première fois sur un singe de laboratoire (en 1958), et le premier cas humain a été détecté en 1970 en République démocratique du Congo. Aujourd’hui, les foyers du virus se situent dans plusieurs pays d’Afrique centrale et de l’ouest. Et de temps en temps, des épidémies surgissent dans d’autres zones géographiques : aux Etats-Unis, en Europe, au Moyen-Orient ou en Asie…
Au printemps 2022, c’est en Europe et en Amérique du Nord que des cas ont été signalés (sans rapport avec des voyages dans les zones où le virus circule de manière active). En France, la plupart des cas confirmés concernent des hommes, et le plus souvent des hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes, et des partenaires multiples.
Une maladie transmise par un animal ou un être humain
La variole du singe est une zoonose. Le virus peut être transmis à l’homme :
- directement par l’animal infecté : le virus est transmis après un contact direct avec l’animal (un singe ou un rongeur, généralement). Ce « contact direct » peut avoir lieu lors d’une morsure ou d’une griffure, mais aussi lors de la manipulation d’une carcasse ou de la préparation de la viande de l’animal. Le virus peut aussi se transmettre au moment de la consommation de l’animal infecté, lorsque la viande n’est pas assez cuite ;
- par une personne infectée : lorsque le virus a pénétré l’organisme d’un être humain, il peut être transmis à un autre être humain. La transmission interhumaine se fait par contact direct avec une personne qui présente une éruption cutanée (principal symptôme de la variole du singe). Le virus se transmet par des lésions de la peau ou des muqueuses (dans la région buccale, anale ou génitale). Si cela reste plus rare, le virus peut aussi être transmis par des gouttelettes respiratoires (en cas de face-à-face prolongé) ou via un contact avec des objets contaminés (une serviette de toilette, par exemple).
Le virus pourrait aussi être transmis de l’être humain à d’autres espèces animales (sensibles à l’orthopoxvirus simien). Les personnes infectées doivent donc éviter tout contact rapproché avec des animaux, au risque de former de nouveaux réservoirs.
Quels sont les symptômes de la variole du singe ?
Après la contamination de l’organisme par le virus, la durée d’incubation de la maladie varie entre 5 et 21 jours.
La variole du singe provoque ensuite l’apparition de symptômes semblables à ceux de la variole, avec deux phases distinctes :
- d’abord de la fièvre, des douleurs musculaires et une fatigue générale : la fièvre est supérieure à 38 °C, et peut être accompagnée de ganglions enflés et douloureux, de frissons et de maux de tête. Dans certains cas, la personne se plaint aussi de maux de gorge et de douleurs à la déglutition (avec des rougeurs dans la bouche et sur la langue) ;
- un à trois jours après, une éruption cutanée : elle apparaît d’abord sur le visage, et s’étend ensuite rapidement au reste du corps. Les lésions peuvent apparaître sur les paumes des mains et les plantes des pieds, ainsi que sur les muqueuses de la bouche, de l’anus et des organes génitaux (elles sont souvent douloureuses). Au fur et à mesure du temps, les boutons évoluent. Au début, ce sont des macules (des taches rouges planes), qui se transforment en papules (lésions surélevées et douloureuses). Elles se remplissent ensuite d’un liquide clair (on parle alors de vésicules), avant de devenir fermes et remplies de pus (pustules). Lorsque les pustules cicatrisent, des croûtes se forment : elles finissent par s’assécher et tomber.
La maladie dure entre 2 et 4 semaines. La personne infectée par la variole du singe devient contagieuse lorsque les premiers symptômes apparaissent. Elle le reste jusqu'à la cicatrisation des lésions et à la chute de toutes les croûtes.
Comment réagir en cas de symptômes ?
Si la maladie reste moins grave que la variole, elle peut néanmoins être mortelle dans certains cas. Il est donc important de consulter son médecin dès l’apparition des premiers symptômes de variole du singe. Après avoir confirmé son diagnostic, il peut prescrire un traitement adapté et indiquer les mesures à prendre pour limiter la transmission du virus.
Pourquoi consulter ?
La variole du singe peut rester bénigne : les symptômes disparaissent en quelques semaines, et la personne guérit. Mais elle peut aussi être à l’origine de plusieurs complications. Certaines personnes peuvent en effet développer des signes plus graves, qui nécessitent parfois une hospitalisation. Les principales complications de la maladie sont une éruption très étendue (qui provoque la chute de grands lambeaux de peau), des douleurs particulièrement intenses, une atteinte de la glotte (avec des difficultés à avaler), une surinfection bactérienne des lésions, une atteinte de la cornée des yeux, des complications neurologiques ou pulmonaires…
Parmi les personnes les plus à risque de développer une forme grave de la maladie, on retrouve les femmes enceintes, les nouveaux-nés et les enfants, et les personnes immunodéprimées. En cas de symptômes, elles doivent immédiatement consulter. Même si la personne qui souffre des symptômes n’est pas considérée comme « à risque », elle doit aussi consulter son médecin : cela permet de confirmer le diagnostic de variole du singe, et de prendre les mesures adaptées pour éviter de contaminer d’autres personnes.
Comment le diagnostic est-il confirmé ?
Après avoir interrogé son patient sur ses symptômes, le médecin se renseigne sur ses derniers voyages et déplacements (dans une zone d’endémie), ou sur ses éventuels contacts avec des personnes infectées. Il procède ensuite à un examen physique complet, pour éliminer d’autres maladies (varicelle, zona, rougeole ou allergie). Il vérifie la présence éventuelle de lésions dans la gorge et la bouche, et sur l’ensemble du corps.
Pour confirmer son diagnostic, il a recours à un examen biologique. Il prélève un échantillon de lésion cutanée (sur un bouton), et réalise un prélèvement au niveau d’une muqueuse (dans le nez, la gorge ou sur une lésion génitale ou anale). Ce prélèvement est ensuite analysé, pour rechercher la présence de l’ADN du virus de la variole du singe (détection du génome du Monkeypox). La variole du singe est une maladie à déclaration obligatoire : une fois le diagnostic confirmé, le médecin doit alerter les services compétents.
Quels sont les traitements prescrits ?
Le traitement de la variole du singe consiste simplement à soulager les symptômes. Il s’agit en effet d’une infection virale, qui disparaît spontanément en quelques jours ou en quelques semaines. La fièvre est traitée avec du paracétamol (ou avec un antalgique plus puissant). Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont déconseillés. Des produits locaux anesthésiques, et des bains de bouche ou de siège peuvent être prescrits pour soulager les douleurs. Des médicaments antiviraux et des immunoglobulines sont parfois prescrits aux personnes les plus fragiles.
Le médecin rappelle tous les gestes barrières à adopter, pour éviter de transmettre la maladie. Il est recommandé de s’isoler au maximum (pendant 3 semaines au moins), de porter un masque chirurgical en présence d’autres personnes, et de se laver les mains très régulièrement. La personne infectée ne doit pas avoir de rapports sexuels (même avec un préservatif), et ne doit pas partager ses affaires et objets personnels. Elle doit aussi éviter tout contact avec les animaux.
En cas de contact étroit avec une personne contaminée, il est recommandé de surveiller l’éventuelle apparition de symptômes pendant les 21 jours qui suivent. Il faut aussi limiter les contacts avec d'autres personnes pendant cette période.
Comment éviter cette maladie ?
En plus d'adopter certains gestes barrières et des mesures d’hygiène indispensables dans les pays à risque, il est aussi possible de se faire vacciner contre la variole du singe. Les personnes nées avant 1977 ont été vaccinées contre la variole. Or, ce vaccin protège partiellement contre la variole du singe. Mais en 1980, la maladie a été considérée comme éradiquée dans la majeure du monde, et la vaccination s’est arrêtée.
Aujourd’hui, un vaccin post-exposition est proposé aux adultes contacts à risque (dans les 4 à 14 jours après le contact, avec deux doses). Une vaccination préventive est également recommandée à certaines personnes.
Sources :
https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/monkeypox
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/variole-singe-monkeypox
https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/infections/poxvirus/variole-du-singe